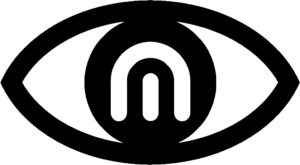
Fiche n°3
Le concept de soutenabilité forte de Herman Daly
Aurèle TRANCHANT – Emilie TRANCHANT – Date de publication : 23 janvier 2025 – MAJ : 26 mars 2025
Comprendre le concept en 1’ chrono
Le concept de soutenabilité forte, développé par Herman Daly, repose sur l’idée que le capital naturel – c’est-à-dire l’ensemble des ressources et services écosystémiques fournis par la nature – ne peut être remplacé par du capital manufacturé ou technologique sans conséquences majeures. Contrairement à la soutenabilité faible, qui admet une substitution entre ces formes de capital, la soutenabilité forte insiste sur l’existence de seuils écologiques infranchissables et sur l’irréversibilité de certaines dégradations environnementales.
Selon Daly, une économie véritablement durable doit fonctionner dans les limites biophysiques de la planète et préserver les ressources naturelles essentielles aux générations futures. Il propose ainsi un modèle de steady-state economy (économie stationnaire), dans lequel la croissance matérielle est stabilisée et remplacée par une amélioration qualitative des processus économiques. Il ne s’agit pas d’un rejet du progrès ou de l’innovation, mais d’une réorientation vers un développement centré sur la résilience des écosystèmes et la qualité de vie plutôt que sur l’accumulation infinie de richesses.
La soutenabilité forte remet en question les fondements de l’économie néoclassique qui, depuis la révolution industrielle, a reposé sur l’idée d’une croissance infinie alimentée par une exploitation illimitée des ressources naturelles. Daly démontre que cette approche est incompatible avec les principes thermodynamiques et écologiques qui régissent le fonctionnement de la biosphère. Il défend ainsi une vision où l’économie est un sous-système de l’environnement global et doit, en conséquence, respecter les capacités de renouvellement et d’absorption des déchets des écosystèmes.
Ce concept a des implications majeures pour les politiques publiques et les stratégies industrielles. La transition énergétique vers les énergies renouvelables, le développement de l’économie circulaire et la régulation stricte de l’exploitation des ressources naturelles sont autant d’applications directes de la soutenabilité forte. À l’échelle des entreprises, cela se traduit par une révision des modèles de production afin de minimiser l’impact environnemental et d’intégrer des principes de sobriété et d’efficacité dans l’usage des matières premières.
Faire le point sur le champ conceptuel connexe
Capital naturel : regroupe l’ensemble des ressources environnementales fournissant des services écosystémiques indispensables (air pur, eau potable, régulation climatique, biodiversité). Selon la soutenabilité faible, ces éléments peuvent être remplacés par des technologies ou des innovations humaines. À l’inverse, Daly rejette cette idée et considère que la perte de capital naturel est irréversible et critique pour le fonctionnement des sociétés humaines.
Capital manufacturé : Il s’agit des infrastructures, des machines et des biens produits par l’homme. Dans le cadre de la soutenabilité faible, ce capital peut compenser la dégradation du capital naturel. Cependant, dans la soutenabilité forte, le capital manufacturé est vu comme complémentaire au capital naturel, et non comme un substitut viable.
Économie stationnaire (Steady-State Economy, SSE) : Daly propose un modèle économique dans lequel la croissance matérielle est stabilisée afin de ne pas dépasser les limites écologiques. Il met en avant la nécessité de réduire la consommation excessive de ressources et de limiter l’accumulation du capital manufacturé pour éviter la surexploitation des écosystèmes.
Connaître l’historique du concept
Le concept de soutenabilité forte est issu des travaux de l’économie écologique, une discipline qui s’est développée en opposition à l’économie néoclassique. Herman Daly, ancien économiste de la Banque mondiale, a largement contribué à la formalisation de ce principe dans les années 1970 et 1980.
Il s’inspire notamment de Nicholas Georgescu-Roegen, qui a démontré que l’économie est soumise aux lois de la thermodynamique, notamment au principe d’entropie, signifiant que les ressources naturelles s’épuisent de manière irréversible. Daly s’oppose ainsi aux visions de la croissance infinie en affirmant que la Terre impose des limites physiques inévitables à l’expansion économique.
Se situer dans le débat
L’opposition entre soutenabilité faible et soutenabilité forte peut se définir de la manière suivante :
- Soutenabilité faible : Défendue par l’économie environnementale classique, elle repose sur l’idée que les innovations technologiques et l’accumulation de capital manufacturé peuvent remplacer la perte de capital naturel. Par exemple, la déforestation pourrait être compensée par des plantations industrielles et des progrès en biotechnologie.
- Soutenabilité forte : Daly et ses partisans (tels que Robert Costanza et Joan Martinez-Alier) affirment que certaines fonctions écologiques ne peuvent être remplacées. Ils soutiennent que l’effondrement de la biodiversité, l’épuisement des sols et le dérèglement climatique ont des conséquences irréversibles et nécessitent une gestion stricte des ressources.
Daly insiste sur la nécessité d’intégrer des indicateurs alternatifs au PIB, tels que l’Indice de Bien-être Économique Durable (IBED), qui prend en compte les dégradations environnementales.
Percevoir l’actualité et l’usage du concept
Dans un contexte marqué par l’aggravation des crises écologiques – changement climatique, perte de biodiversité, pollution des sols et des océans – la soutenabilité forte apparaît comme une approche de plus en plus pertinente et nécessaire. Le dernier rapport du GIEC souligne que la poursuite d’une trajectoire de croissance matérielle fondée sur l’exploitation intensive des ressources naturelles entraîne des perturbations irréversibles des équilibres climatiques et écologiques. La communauté scientifique insiste ainsi sur la nécessité d’un changement de paradigme, en privilégiant une réduction des pressions exercées sur l’environnement plutôt qu’une simple adaptation technologique aux dommages causés.
Cette prise de conscience se traduit progressivement dans les politiques publiques, notamment en Europe, où le Pacte vert vise à intégrer des limites écologiques dans les stratégies de développement. L’interdiction progressive de certaines pratiques destructrices, comme l’exploitation minière intensive ou la destruction de forêts primaires, illustre cette transition vers une approche de soutenabilité forte. Néanmoins, ces politiques restent souvent confrontées aux résistances des acteurs économiques dominants, qui privilégient encore une vision fondée sur l’optimisation de la croissance et la compensation des dommages environnementaux plutôt que sur leur prévention.
Approfondir : les références utiles
Daly, Herman E. Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, 1996.
« La croissance infinie dans un monde fini est une impossibilité physique. » (Daly, 1996) – (http://pinguet.free.fr/daly1996.pdf)
Georgescu-Roegen, Nicholas. The Entropy Law and the Economic Process, 1971. (https://content.csbs.utah.edu/~lozada/Adv_Resource_Econ/En_Law_Econ_Proc_Cropped_Optimized_Clearscan.pdf)
Rapport du Club de Rome, The Limits to Growth (1972) – (https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/)
Publications du GIEC sur le changement climatique et les limites planétaires – (https://wmo.int/fr/media/magazine-article/rapport-special-du-giec-sur-le-rechauffement-planetaire-de-15-degc#:~:text=Le%20rapport%20du%20GIEC%20souligne,diminution%20de%20la%20banquise%20arctique.)
Études sur l’économie circulaire et la transition énergétique (https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/economie/article/l-economie-circulaire)
Les infos pratiques de [La boîte]
Mail : emilie@laboiteamots.fr
Charte déontologique et engagements
CGV
Mentions légales et CGU de laboiteamots.fr
Et vous, quel sera votre choix ?
Option 1 : une stratégie sans action
> un rêve
Option 2 : une action sans stratégie
> un cauchemar
Option 3 : nous appeler
![[La boîte à mots]](https://laboiteamots.fr/wp-content/uploads/2024/03/www.laboiteamots.fr_.png)
