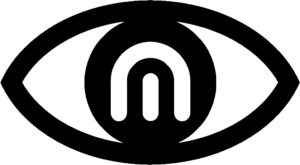
Fiche n°2
Le Lobbying
Aurèle TRANCHANT – Emilie TRANCHANT – Date de publication : 23 janvier 2025 – MAJ : 23 mars 2025
Comprendre le concept en 1’ chrono
Le lobbying désigne l’ensemble des stratégies d’influence utilisées par des groupes d’intérêts pour orienter la prise de décision publique en leur faveur. Il repose sur une interaction continue entre les sphères économiques, politiques et administratives, et prend différentes formes, allant de la rencontre directe avec les décideurs politiques à la mobilisation de l’opinion publique.
D’un point de vue théorique, le lobbying est perçu soit comme un instrument légitime de représentation des intérêts, soit comme un moyen de captation du pouvoir public par des acteurs privés. Son efficacité dépend de plusieurs facteurs :
- La capacité d’expertise des lobbyistes, qui apportent aux décideurs politiques des analyses détaillées.
- Les ressources financières et stratégiques investies pour influencer le processus législatif.
- La régulation légale du lobbying, qui varie fortement selon les pays.
L’OCDE souligne que « le lobbying est une composante essentielle du processus démocratique, mais il peut également être une source de corruption et d’inégalités d’accès aux décisions publiques. » (Recommandations de l’OCDE sur le lobbying, 2010).
Alors, le lobbying oscille entre outil de participation démocratique et mécanisme de distorsion du jeu politique. La question à se poser est donc jusqu’à quel point l’influence privée sur l’action publique est-elle acceptable ?
Faire le point sur le champ conceptuel connexe
Lobbying et démocratie représentative : le lobbying peut être interprété comme une extension du pluralisme démocratique, permettant aux différents groupes sociaux et économiques de faire valoir leurs intérêts auprès des gouvernants. Cependant, lorsqu’il est exercé de manière opaque ou disproportionnée, il favorise une privatisation du débat public, où seules les voix disposant des ressources nécessaires parviennent à se faire entendre.
Capture du régulateur : lorsque les instances publiques de régulation deviennent trop proches des entreprises qu’elles supervisent, elles cessent d’agir dans l’intérêt général et adoptent des mesures favorisant les acteurs dominants du marché. Ce phénomène, identifié par George Stigler (The Theory of Economic Regulation, 1971), est un effet pervers du lobbying qui transforme l’État en outil au service des intérêts privés.
Capitalisme de connivence : le lobbying joue un rôle clé dans l’émergence du capitalisme de connivence, un modèle économique où les réussites ne dépendent plus de l’innovation et de la concurrence, mais de la proximité avec le pouvoir politique. Ce système crée des distorsions économiques, notamment en matière d’attribution des marchés publics, de régulations sur mesure ou d’aides étatiques.
Connaître l’historique du concept
Le lobbying est une pratique ancienne, mais sa structuration moderne date du XIXe siècle. Le terme vient des groupes d’intérêts qui, aux États-Unis, attendaient dans les halls (« lobbies ») du Congrès pour rencontrer les législateurs.
Dans les démocraties libérales, l’influence des groupes d’intérêt s’est institutionnalisée au fil du temps : en 1946 avec le Federal Regulation of Lobbying Act aux USA qui impose un premier cadre déclaratif aux activités de lobbying. En 1995, le Lobbying Disclosure Act qui contraint les lobbyistes à enregistrer leurs activités. Et enfin en 2011, cette fois l’Union Européenne, voit la création du Registre de transparence de l’UE, répertoriant les acteurs influençant la législation européenne.
Aujourd’hui, le lobbying est une industrie mondiale : à Bruxelles, on estime que près de 12 000 lobbyistes travaillent auprès des institutions européennes, influençant 75 % des législations européennes (Transparency International, 2022).
Se situer dans le débat
Les défenseurs du lobbying
Les partisans du lobbying le considèrent comme un instrument essentiel de la démocratie représentative. Il permet aux différents acteurs économiques, sociaux et associatifs de faire entendre leur voix et d’orienter les politiques publiques en fonction des réalités du terrain. Dans cette perspective, le lobbying jouerait un rôle d’intermédiation entre les gouvernants et la société civile, en apportant une expertise technique et en facilitant la prise de décisions éclairées.
Un premier argument en faveur du lobbying repose sur son apport en matière d’expertise technique. Les décideurs politiques, souvent confrontés à des sujets complexes, ne disposent pas toujours des connaissances nécessaires pour réguler certains secteurs spécialisés (santé, énergie, numérique, etc.). Les groupes d’intérêt, en particulier les entreprises et les syndicats, fournissent aux législateurs des données techniques et des études de cas, permettant d’élaborer des politiques publiques mieux adaptées à la réalité économique et sociale.
Un deuxième argument concerne la défense des intérêts minoritaires. Contrairement à l’image dominante d’un lobbying exclusivement exercé par les multinationales, de nombreux groupes d’intérêt représentent des causes sociétales telles que l’environnement, la santé publique ou encore les droits des travailleurs. Les ONG, les associations de consommateurs ou encore les syndicats s’appuient ainsi sur le lobbying pour contrebalancer l’influence des grandes entreprises et promouvoir des régulations plus favorables à l’intérêt général.
Enfin, certains considèrent que le lobbying favorise la transparence des processus décisionnels, à condition qu’il soit encadré par des règles strictes de déclaration et de contrôle. Un cadre légal bien défini permettrait d’institutionnaliser la participation des groupes d’intérêts à l’élaboration des lois, évitant ainsi que des décisions majeures ne soient prises en vase clos par des élus isolés du reste de la société.
Les critiques du lobbying
À l’opposé, les détracteurs du lobbying y voient une forme de captation de l’action publique par des intérêts privés. Ils dénoncent une asymétrie d’influence entre les différents groupes d’intérêt, où les acteurs les plus riches et les mieux organisés disposent d’un accès privilégié aux décideurs politiques. Les grandes entreprises, en particulier les multinationales, bénéficieraient ainsi d’un avantage déloyal, qui leur permettrait d’infléchir les politiques publiques en fonction de leurs propres intérêts économiques.
Un premier reproche adressé au lobbying concerne les conflits d’intérêts et le phénomène des « portes tournantes »(revolving door). Il est courant que des hauts fonctionnaires ou des élus rejoignent le secteur privé après leur mandat, ce qui pose la question de leur impartialité dans la prise de décisions publiques. À titre d’exemple, de nombreux anciens commissaires européens ont intégré des conseils d’administration de grandes entreprises après avoir quitté leurs fonctions, nourrissant le soupçon d’une régulation taillée sur mesure pour favoriser certains acteurs économiques.
Un deuxième problème réside dans l’opacité des décisions publiques. Si certains États imposent aux lobbyistes de déclarer leurs activités et les montants investis dans l’influence politique, ces mesures restent largement insuffisantes pour garantir une véritable transparence. En Europe, des enquêtes journalistiques ont révélé que des projets de lois entiers avaient été co-rédigés par des cabinets de lobbying représentant les intérêts de multinationales. Cette réalité pose la question du rôle des élus dans la fabrique de la loi, et de leur capacité à résister à la pression des intérêts privés.
Percevoir l’actualité du concept
Ces pratiques et ses conséquences se sont mises en avant autour des groupes pharmaceutiques lors la gestion mondiale du COVID-19. Les accords entre Pfizer, Moderna et l’Union Européenne ont été négociés à huis clos, sans publication des clauses tarifaires ou des engagements des États. Cette absence de transparence a été dénoncée par la Médiatrice européenne, qui a pointé un lobbying excessif des laboratoires sur la Commission. Mais, malgré la demande de l’OMS d’assouplir la propriété intellectuelle des vaccins pour permettre une production mondiale à bas coût, les entreprises pharmaceutiques ont mobilisé leurs réseaux d’influence pour bloquer cette initiative.Résultat : les pays en développement ont eu un accès restreint aux vaccins pendant la pandémie.
De surcroît, les agences sanitaires, censées protéger l’intérêt public, ont été prises dans un conflit d’intérêts : une partie de leur financement dépend des laboratoires, rendant leur indépendance fragile. Ce cas illustre comment le lobbying pharmaceutique peut interférer avec des décisions de santé publique, au détriment de l’accès universel aux soins.
Approfondir : les références clés et liens utiles
Lobbying et Influence (OCDE) – https://www.oecd.org/fr/topics/sub-issues/lobbying.html
Lobbying : l’influence des groupes d’intérêt s’accroît, et favorise une transformation de notre modèle démocratique : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://millenaire3.grandlyon.com/content/download/1385/fichier_associe/lobbying.pdf&ved=2ahUKEwiC6NDryJGMAxXn_7sIHaRpOsEQFnoECDUQAQ&usg=AOvVaw1kUv3iW8CVC58Ayx6pmXWo
Les recommandations de l’OCDE : https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/256/256.fr.pdf
Les infos pratiques de [La boîte]
Mail : emilie@laboiteamots.fr
Charte déontologique et engagements
CGV
Mentions légales et CGU de laboiteamots.fr
Et vous, quel sera votre choix ?
Option 1 : une stratégie sans action
> un rêve
Option 2 : une action sans stratégie
> un cauchemar
Option 3 : nous appeler
![[La boîte à mots]](https://laboiteamots.fr/wp-content/uploads/2024/03/www.laboiteamots.fr_.png)
